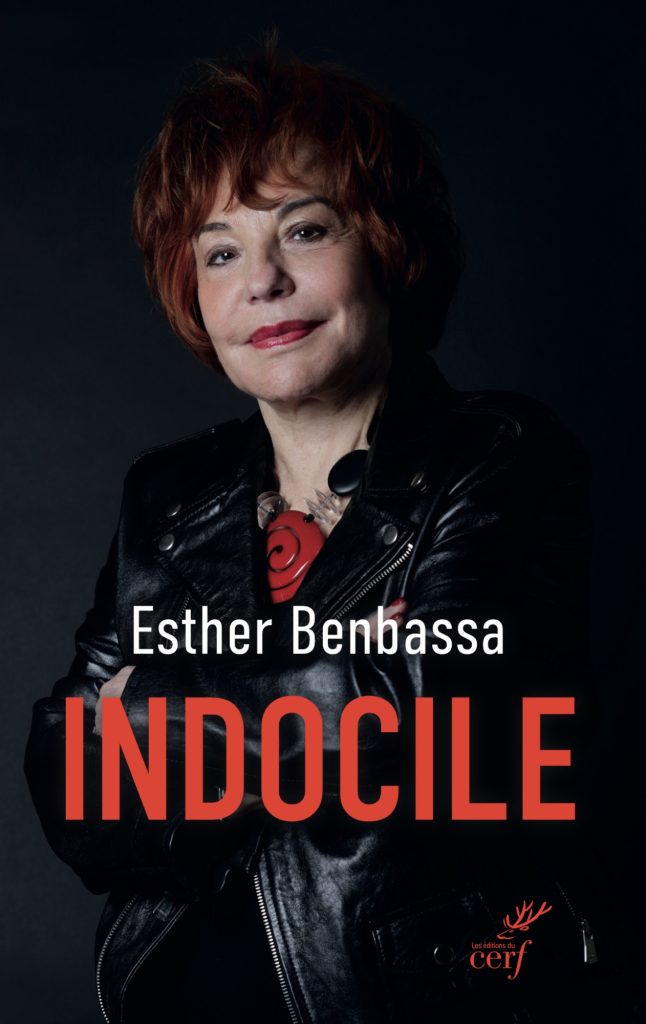
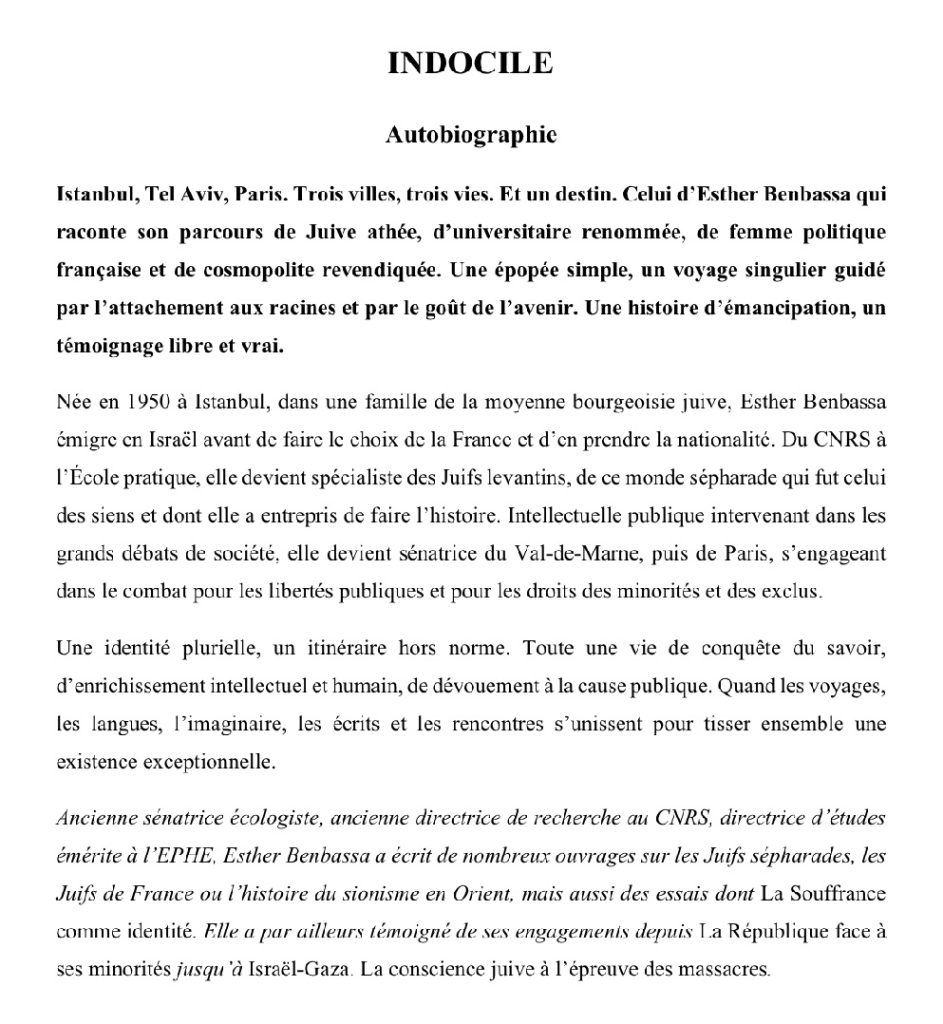
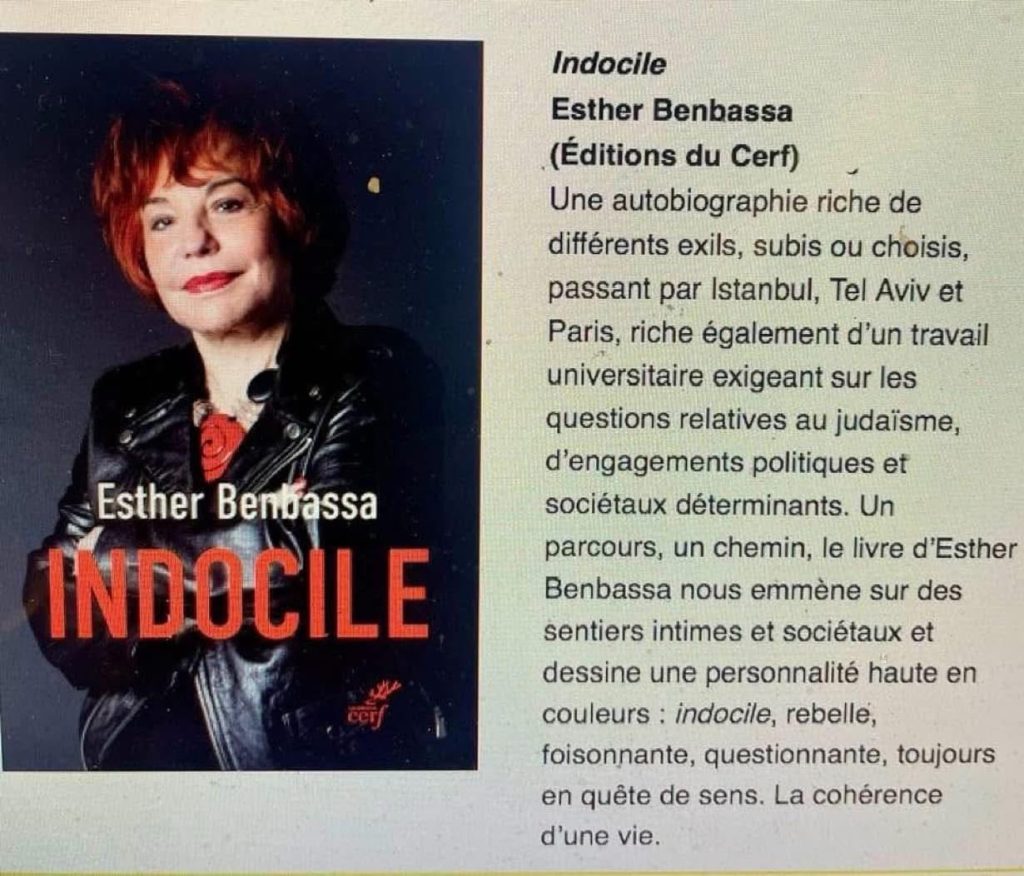
Extraits
#Istanbul, milieu des années 1950 « Je passais mon temps à rêver. À avoir peur de ma mère, aussi. Elle provoquait chez moi une anxiété qui renforçait mon repli. Un jour où l’on repeignait notre appartement, elle m’autorisa à descendre dans l’entrée de l’immeuble pour m’éviter d’inhaler la mauvaise odeur que dégageaient les peintures de l’époque. Elle m’intima de n’ouvrir la porte de l’immeuble à personne. Comme je regardais vers l’extérieur, je vis des enfants s’approcher et frapper sur la vitre pour que je leur ouvre. Il s’agissait de petits tsiganes dont les parents, en général, vivaient de la vente de fleurs dans la rue. Je transgressai les consignes de ma mère et entrouvris la porte. Je jouai un petit moment avec eux puis les suivis jusque dans un quartier bien éloigné. Leur cahute était délabrée, en désordre, mais les parents étaient accueillants. Je passai la nuit avec eux, contente de ne plus être seule dans notre appartement, dont les fenêtres donnaient sur un cimetière catholique dont je recomptais chaque jour les croix et les tombes, assistant à distance à des funérailles où tout le monde était habillé en noir. Je n’entendais pas les pleurs. Ni les lamentations. Mais j’étais en mesure de les imaginer.
« Chez mes nouveaux amis tsiganes, l’atmosphère était bien différente, agitée, les enfants criaient, les parents parlaient dans une langue, une de plus, que je ne connaissais pas. Je ne comprenais d’ailleurs pas non plus ce que disaient les enfants puisque je ne parlais pas encore le turc et qu’eux-mêmes ne parlaient bien sûr ni le judéo-espagnol ni le grec. J’étais juste heureuse. Le lendemain, dans l’après-midi je vis mon père débarquer avec des forains, qui m’avaient cherchée pendant de longues heures. Je ne me souviens que de la joie de mon père. La suite s’est effacée de ma mémoire. Le souvenir de cette fugue m’a longtemps intriguée. Je n’étais probablement pas très heureuse chez moi. Rien d’extraordinaire, sans doute. Mais je n’avais guère plus de cinq ans… »
Israël 1965. « En général, ceux qui arrivaient en Israël avec le statut d’immigrés (juifs) avaient droit à une location à un prix modique. Avec ses relations dans l’administration, mon oncle prestidigitateur, un peu voyou, réussit à nous obtenir un minuscule appartement dans une petite agglomération couverte de sable, avec des immeubles à colonnes qui sortaient de terre à une vitesse exceptionnelle : Ramat-Éliahou, une banlieue de Rishon-Le-Zion, à 15 km au sud de Tel-Aviv. On construisait en masse pour répondre à l’arrivée incessante d’immigrés dans ces années 1960. Des immeubles qu’on aurait crus de carton au beau milieu des dunes. On ne pouvait même pas marcher avec des chaussures ; nous les enlevions pour avancer.
« Ma mère et moi, nous découvrions, stupéfaites, un environnement qui n’était que misère et désolation. Des plantes bizarres poussaient ici et là dans le sable. Un bus passait toutes les deux ou trois heures. Il n’y avait pas d’école sur place, il fallait se déplacer dans l’agglomération qui se trouvait à quelques kilomètres de ce désert. Il n’y avait même pas de ramassage scolaire. Je me rappelais mon père qui, à Istanbul, tous les matins, surveillait l’arrivée et le départ du bus privé qui m’emmenait autrefois à l’école. Ni cinéma, ni théâtre, ni opéra, ni restaurants. Juste un vendeur de falafel – boulettes frites à base de pois chiches très appréciées au Moyen-Orient, qu’on ne connaissait pas en Turquie –, dans un coin glauque de la cité-dortoir, qui ouvrait à la sortie du shabbat. Quelques épiceries presque vides. Absolument rien d’autre. Istanbul était bien loin. On laissait mon frère chez une des tantes pour lui épargner cette horreur. La chaleur était accablante. On voyait la mer, très loin, qui se perdait derrière les dunes… »
France, début des années 1970. #Féminisme. « À la cité universitaire, on assistait aussi au bouillonnement d’un féminisme radical. Se maquiller, porter des bottes ou des jupes revenait à trahir la cause. Bien sûr, c’était l’écume des choses. Il y avait le cœur des luttes, que j’approuvais totalement. En même temps, je constatais le fossé entre la condition de la femme dans ma culture et ces revendications légitimes. Les femmes du monde d’où je venais avaient subi la misogynie, les mariages arrangés, les servitudes du foyer et toutes les névroses qui en résultaient. Même lorsqu’on leur permettait de travailler, elles ne gagnaient pas assez pour subvenir à leurs besoins. Il fallait se marier vierge, donner la dot au marié, se préparer un trousseau, être humble et obéissante. La religion n’était pas seule à l’origine de ces diktats. Certes, avec l’instruction des filles et l’acquisition de nouveaux métiers, les traditions reculaient, mais leur poids était tout de même encore très lourd.
« (…) En Israël, les Levantines
avaient souvent un emploi, mais des travaux ancillaires pour la plupart, insuffisants pour leur permettre d’accéder à une véritable autonomie. Tout cela n’aida pas à faire avancer sensiblement le statut de la femme juive d’Orient et la question de ses libertés. C’est à la maison qu’elle détenait le pouvoir. Cet espace était ordinairement son seul royaume.
« Dans les cercles féministes de la cité, on n’évoquait quasiment pas les violences sexuelles et les féminicides. Et pourtant, les violences et les viols n’y étaient pas rares. J’en ai moi-même fait la sinistre expérience. Nous avions honte d’en parler comme si nous, les femmes, en étions responsables. Nous n’en parlions même pas entre nous. Alors que nous avions théoriquement le moyen de les dénoncer à l’administration. Lorsque je vois aujourd’hui les « néo-féministes » porter ce combat sans relâche à la suite de #Metoo, je ne peux qu’être fière d’elles.
« J’ai beaucoup appris sur moi et sur les femmes en général au contact des féministes de la cité universitaire. Je découvris surtout que je ne devais pas mépriser celles qui m’avaient élevée et entourée, qu’il était temps de tâcher de mieux les connaître, d’hériter de leur savoir-faire, et d’apprécier leurs efforts pour nous pousser à faire des études afin de connaître une vie meilleure. Finalement, en partant seule en France, j’avais accompli un pas de géant vers l’émancipation. Mais je voulais garder le meilleur de ces femmes de mon entourage familial. Leur courage et leur résistance me guidaient. Elles ne me servaient pas de modèle, mais elles m’encourageaient à avancer. »
#Ecologistes. « J’ignore si l’on peut parler d’une idéologie écologiste. Difficile en tout cas de créer le consensus en pareil milieu. Encore aujourd’hui ce parti se déchire pour un oui ou pour un non. À cette différence près, désormais, qu’une certaine forme de stalinisme a remplacé l’atmosphère libertaire où chacun pouvait trouver sa place – et entretenir le désordre à son gré. Des tendances radicales, déviant de leurs objectifs premiers et légitimes de défense des droits des minorités, ont créé un nouveau climat. Ce qui est bien dommage. Les exclusions, les bagarres autour de la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, le féminisme caricatural de quelques-unes, l’absence de ligne claire, le manque d’objectifs précis, interdisent de penser que ce parti puisse jamais devenir un parti régalien. Rien ne l’y prédispose. Beaucoup de jeunes qui y adhèrent, parfois issus de Sciences Po, le font parce qu’ils pensent qu’on peut obtenir un poste plus facilement là qu’ailleurs. Ces dernières années, EELV s’est transformé en une cour d’école, âgiste, minée par la brutalité et l’opportunisme, politiquement peu efficace, dépassée par l’écologie militante, hors partis, de jeunes gens non encartés et plus radicaux encore, qui organisent des événements spectaculaires pour attirer l’attention de la population sur l’état de la planète, le réchauffement climatique, la biodiversité, l’alimentation, etc. Ce n’est certes pas la première fois que les écologistes d’EELV comptent dans leurs rangs des coupeurs de têtes, surtout de celles qui dépassent. Les anciens aussi coupaient des têtes, ce n’était pas sympathique, mais au moins se fixaient-ils des objectifs à peu près clairs. Bref, dans ce parti, on ne sait plus où l’on va, submergé qu’on est par une radicalité à la fois âpre et brouillonne. »
Échos et recensions
15 octobre 2025 : L’Histoire
Difficile de définir Esther Benbassa, Juive athée, Française conservant un accent de sa jeunesse turque, née à Istanbul, grandie à Tel Aviv, installée à Paris, cosmopolite assumée et même revendiquée. De son père, elle tient la certitude que l’éducation constitue une richesse inestimable et elle mettra tout au long de sa vie autant d’énergie à apprendre qu’à enseigner à ses élèves puis à ses étudiants, les aidant à se hisser à leur meilleur niveau. De sa mère, elle hérite les secrets de la cuisine judéo-espagnole qu’elle rassemble dans un livre – le seul épuisé de cette universitaire renommée, avoue-t-elle avec humour…
L’autobiographie, qu’elle a rédigée une fois sa retraite officielle prise, est à son image, mêlant souvenirs personnels contrastés et itinéraire intellectuel et politique finalement très tôt liés : son enfance et son adolescence « cabossées », et les émigrations successives l’ont littéralement « déroutée » mais ont aussi nourri son insatiable curiosité.
Polyglotte qui « habite toutes les langues sans les posséder », qui fait du « souci de l’autre un des vecteurs de [sa] conduite », qui reconnaît pouvoir se tromper mais ne pas savoir tricher, elle a très tôt refusé de n’être qu’une savante. Elle est devenue, comme le lui enjoignit Pierre Vidal-Naquet, qui bouleversa sa vie et ses engagements, une intellectuelle dans la cité, par son enseignement, ses prises de position publiques, ses tribunes et bien sûr ses mandats de sénatrice écologiste. Dans cette fonction, elle s’empara résolument des dossiers les plus sensibles, discriminations, prisons, centres de rétention, droits des migrants, prostitués, LGBTQ+, reconnaissance des événements de 1961, légalisation du cannabis et bien d’autres.
Elle revient sur ses erreurs, ses doutes, les trahisons et lâchetés qui l’ont blessée, les rencontres et hasards qui l’ont ravie, dont bien sûr celle de Jean-Christophe Attias, historien du judaïsme qu’elle épousa en 1988, la difficulté aussi à être une Juive soutenant la cause palestinienne, assommée par les massacres du 7 Octobre, révoltée par l’horreur endurée par les Palestiniens, mais qui, inlassablement optimiste, nous incite à planter « des étoiles dans le ciel avant que les nuages ne nous envahissent pour longtemps ».
26 juin 2025 : Radio Aligre FM
« Turquie, Israël , France. Trois vies et une personnalité hors du commun, un tempéramment forgé par les épreuves traversées et par le goût pour la recherche, l’histoire, l’art, la culture.
« Esther Benbassa, à la demande de son ami Jean-François Colosimo, directeur des éditions du Cerf, raconte son histoire et ses engagements en tant qu’intellectuelle, professeure à l’Ecole pratique des hautes études puis femme politique, sénatrice d’Europe écologie les verts de 2011 à 2023. Une passionnante aventure humaine. Un portrait de femme forte qui ne craint pas de dévoiler ses fragilités, et qui puise son inspiration dans ses idéntités plurielles. Démarche salutaire en ces temps de replis et de conflits sourds ou déclarés. »
9 juin 2025 : Marenostrum
« Un témoignage fort, d’une rare densité, sur l’exil, la mémoire sépharade et l’élévation par le savoir. Une écriture sobre, au service de la vérité. »
15 mai 2025 : pressedusoir.com (entretien)
29 avril 2025 : Marc Cheb Sun
8 avril 2025 : Radio Notre-Dame
« « Raconter sa vie, c’est descendre dans les tripes, les douleurs », relève Esther Benbassa en écho au travail autobiographique qu’elle a fourni pour raconter son histoire, jalonnée de photos familiales émouvantes. Passée par #Istanbul, #TelAviv et #Paris, l’ancienne sénatrice écologiste dit ce qu’elle doit au français et à la France, ce pays de la #liberté, de l’#émancipation. Elle se souvient aussi d’épisodes tragiques comme le pogrom de 1955 en Turquie dont elle réchappa en se cachant dans une cave. Celle qui a enseigné l’histoire des #religions pendant 43 ans se dit « juive athée » mais elle se rappelle ce moment d’enfance où elle rencontra Jésus chez des amis arméniens d’Istanbul. Esther Benbassa, épouse de l’intellectuel juif Jean-Christophe Attias, descend de juifs expulsés d’Espagne en 1492. Son propos invite à s’interroger sur la place de la mixité, de l’accueil dans des sociétés ouvertes aux quatre vents des migrations planétaires. Qu’est-ce qui nous structure aujourd’hui ? Par quelles influences devenons-nous ce que nous sommes ? Pourquoi et pour quoi vivrions-nous ensemble ? »
28 mars 2025 : rainfolk.com
« Esther Benbassa… livre un récit bouleversant sur son parcours personnel et ses combats pour la mémoire, la transmission et la reconnaissance des minorités. »
